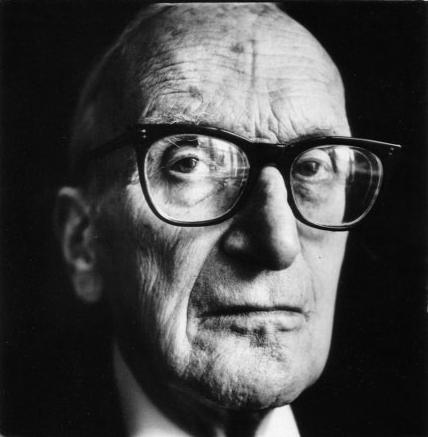
Dans
l’univers complexe de la théorie positiviste du Droit, Herbert Lionel Adolphus
HART (1907-1992) tient une place centrale, quoi qu’injustement occultée par l’aura
extraordinaire, presqu’exclusive, que l’on accorde à son contemporain, Hans
KELSEN. Pur produit de l’Université d’Oxford - dont il occupa la Chaire de
Théorie du Droit de 1952 à 1968 – HART est avant tout un praticien qui perça,
sur le tard et après un parcours peu orthodoxe, dans le monde universitaire. Il
reste que son œuvre majeure, The Concept
of Law (1961), reste sans aucun doute une référence incontournable pour quiconque
cherche à comprendre ce qu’est le Droit, et la place très particulière qu’il
occupe dans l’organisation de notre société.
HART
est loin d’être un auteur consensuel, tant il s’est opposé à presque l’ensemble
des grands noms du Droit de son époque (Hans KELSEN, Ronald DWORKIN, John
RAWLS, Lord Patrick DEVLIN…). Mais son œuvre théorique n’est pas pour autant en
rupture avec ses contemporains : il partage avec eux l’ADN de la théorie
positiviste, cette idée que le Droit est avant tout un système de normes dont l’alpha et l’oméga ne peuvent être un droit idéal, conforme à la nature soit des
choses, soit de l’Homme ou soit encore d’une croyance religieuse. Ainsi, parmi
tous les systèmes normatifs envisageables, HART cherche à comprendre ce qui
fait la particularité, la spécificité des normes de Droit.
Là
où John AUSTIN (à ne pas confondre avec John Langshaw AUSTIN) avait avancé,
dans The Province of Jurisprudence
determined (1832) que toute règle de Droit se définit comme un
commandement, HART réfute cette analyse (« une dénaturation du Droit »,
dit-il) en relevant que s’il devait en être ainsi, le Droit ne serait pas
différent des ordres que donne le bandit à ses victimes aux fins qu’elles lui
remettent leur bourse (et dont la sanction serait le meurtre), ou des autorités
morales qui ordonnent aux Hommes de respecter tel ou tel principe de vie (et
dont la sanction serait la réprobation du groupe). En conséquence, HART refuse
de réduire l’idée de Droit à celle de sanction, consubstantielle au
commandement, et entrevoit qu’en réalité, le Droit se présente sous une forme
bien plus complexe.
Certes
il existe en Droit comme dans d’autres systèmes normatifs, des « règles
primaires » qui prescrivent des comportements, actifs ou passifs, sous la
forme d’obligations : « il est interdit de rouler à plus de 130 km/h
sur les autoroutes », « il est interdit de tuer », « il
faut porter assistance à ses parents »… Mais ce qui distingue le Droit des
autres systèmes normatifs, nous dit HART, c’est qu’il y existe aussi des « règles
secondaires » qui organisent la vie des règles primaires au sein du
système juridique. Parmi elles,
·
Les règles de changement, qui habilitent
certaines autorités à produire de nouvelles règles primaires, ou à modifier ou
supprimer celles qui existent déjà ;
· Les règles d’adjudication, qui habilitent certaines autorités à juger les litiges et qui fixent les procédures à suivre pour ce faire ;
· Les règles de reconnaissance, qui précisent les critères qui indiquent, de façon « positive et décisives », que telle règle primaire est bien une règle de droit ;
Dans cet ensemble, les règles de reconnaissance sont évidemment les plus fondamentales, car ce sont elles qui apposent le label « règle de Droit » sur telle ou telle norme, et qui permettent dès lors aux règles de changement et d’adjudication de jouer leur rôle. Que nous apprend HART sur ces règles si déterminantes ?
Tout
d’abord, elles représentent « une forme
de coutume judiciaire qui n’existe que si elle est acceptée et mise en pratique
par les juridictions dans leurs activités d’identification et d’application du
droit ». Nous sommes donc face à une convention sociale, adoptée et
pratiquée par les juges qui ont l’autorité d’agir ainsi.
Ensuite,
elles contiennent des critères qui, même s’ils varient d’un système de Droit à
un autre, partagent le double objectif d’une part d’identifier les règles
juridiques, d’autre part d’affirmer leur validité. Ainsi parmi ces critères, se
trouveront évidemment des critères purement formels (règle issue d’une autorité
habilitée, respect d’une procédure donnée…). Mais, nous dit HART, étant donné
que l’on entend également affirmer la validité d’une règle primaire, la règle
de changement peut aussi contenir des critères substantiels, c’est-à-dire qui
portent sur le contenu de la règle primaire, et qui sont de nature morale et/ou
politique. C’est évidemment sur ce dernier point (ce que HART appelle un « positivisme
tempéré ») que la controverse avec les positivistes les plus radicaux,
ceux qui sont les plus attachés à l’idée d’une Théorie pure du Droit (comprendre, un Droit épuré de toute considération
morale, politique, historique, sociologique…), a pris naissance. Aujourd’hui
encore, elle anime le débat doctrinal en rendant possible, au contraire de ce
que soutenait KELSEN, des interactions entre le positivisme juridique et la
considération éthique. Il nous faut, sur ce point, préciser la pensée de HART.
Si
HART fait effectivement preuve de réalisme en pointant la capacité du juge à
rétablir un lien entre l’éthique et le droit positif, il ne souscrit pas pour
autant aux affirmations du courant réaliste américain qui considère que le juge,
fondé sur son arbitraire, est l’unique créateur du droit positif. C’est que,
nous dit-il, les règles de Droit ont toutes un « noyau de signification
établie » qui lie le juge dans l’interprétation qu’il fait de celles-ci.
Certes, selon la qualité de la formulation que retient le législateur, il y
aura toujours l’intervention d’une marge d’appréciation personnelle, tout comme
il est indiscutable que les énoncés juridiques s’appuient sur des termes qui
peuvent avoir plusieurs significations et/ou peuvent évoluer dans leur sens
(HART désigne ici la « texture ouverte » des énoncés juridiques). Dès
lors si l’influence des convictions morales et/ou politiques du juge dans l’œuvre
de « dire le Droit » est indéniable, elle reste néanmoins limitée.
HART
reste donc attaché à la distinction entre le Droit, appréhendé comme un ensemble
de normes spécifiques, et la Justice qui est l’objectif éthique que poursuit le
juge à partir de son interprétation des règles de Droit et de leur adaptation
aux cas d’espèce qui lui sont soumis… mais, tout en restant distinctes par
nature, l’un et l’autre sont inévitablement amenées à se rencontrer par le
biais de l’oeuvre judiciaire, et à produire une étrange alchimie qui les
nourrit l’un et l’autre, dans une mesure certes relative mais indéniable. L’imperméabilité
absolue entre l’Ethique et le Droit est donc, dans une perspective hartienne, un
dogme kelsénien contestable dans son intransigeance. Il n’en demeure pas moins
que pour HART, comme pour KELSEN, l’idée de Droit désigne un ensemble de normes
de « devoir-être » (Sollen) qui ne sont pas réductibles aux
phénomènes du factuel et de l’ « être » (Sein).
Observons
une autre différence fondamentale d’avec la pensée de KELSEN. Alors que ce
dernier propose de concevoir l’ordre juridique comme une pyramide de normes, où
chacune est considérée comme valide dès lors qu’une norme supérieure en dispose
ainsi, ce qui suppose in fine qu’au
début de la chaîne de validité se trouve une Constitution originelle qui n’est rien d’autre qu’une fiction (de l’aveu
même de KELSEN), HART propose un modèle plus souple, plus concret, fondé sur la
seule articulation des règles primaires et secondaires, et dont la
représentation n’est pas nécessairement pyramidale. C’est ainsi que certains
disciples de HART - François OST et Michel VAN DE KERCHOVE - ont récemment
proposé un modèle de « Droit en réseau » qui parait bien plus adapté
à l’organisation sociale contemporaine. Nous y reviendrons dans un prochain
article.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire